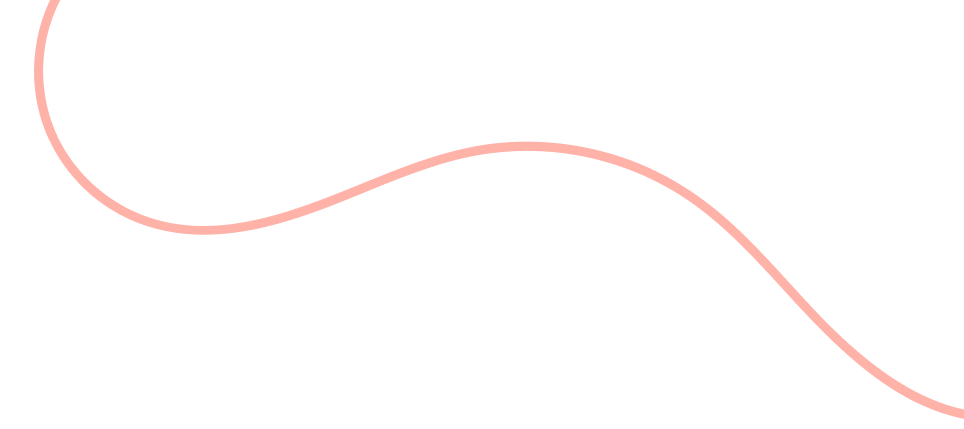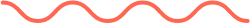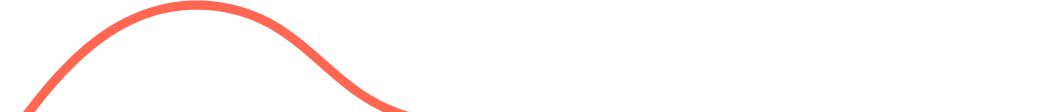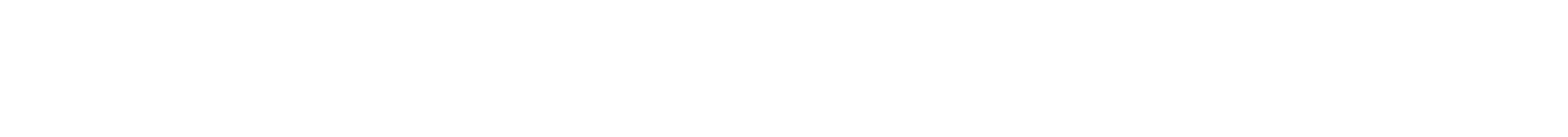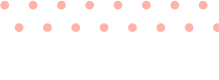Partager les savoirs issus des sciences humaines et sociales ne relève pas d’un simple exercice de vulgarisation. C’est un acte politique, qui engage une certaine vision du monde et une conception de la place du savoir dans la société. En anthropologie comme en sociologie, les connaissances produites ne sont jamais neutres : elles dérangent, questionnent, déplacent les évidences. C’est pourquoi leur diffusion publique suscite à la fois des espoirs — celui d’une société plus éclairée — et des résistances, dès lors qu’elles viennent bousculer des intérêts établis ou des croyances bien ancrées.
La question de qui parle et à qui reste centrale. Un savoir critique, s’il reste confiné dans les cénacles académiques, perd sa portée transformative. Mais une diffusion sans précaution — déconnectée des contextes de production, des incertitudes méthodologiques et des tensions théoriques — risque de trahir la complexité même de ces savoirs. L’enjeu est donc de trouver un équilibre entre rigueur et accessibilité, entre fidélité à la recherche et capacité à susciter une écoute dans des espaces non académiques.
Ce travail suppose un effort de traduction — au sens fort — : non pas simplifier, mais rendre intelligible. Cela demande aussi de reconnaître que la réception du savoir dépend de la position sociale, du vécu, et des attentes de celles et ceux à qui on s’adresse. En cela, diffuser les sciences humaines et sociales, c’est aussi faire retour sur nos propres catégories d’analyse, nos cadres de pensée, nos angles morts.
Il ne s’agit donc pas simplement de transmettre un contenu, mais de participer à une dynamique de transformation mutuelle. Comme le rappelle Clifford Geertz, “l’anthropologie consiste à rendre le familier étrange et l’étrange familier” — et cette opération, pour être fructueuse, suppose un dialogue constant entre chercheurs, praticiens, citoyens.
La diffusion du savoir n’est pas une fin en soi. Elle est un processus relationnel, critique et profondément politique.
![Anthropo[logiques]](http://teckne.cluster010.ovh.net/anthropologiques/wp-content/uploads/2025/07/cropped-MinimalistBlackBeigeTypographyFashionBusinessLogo_20250222_215146_0002.png)