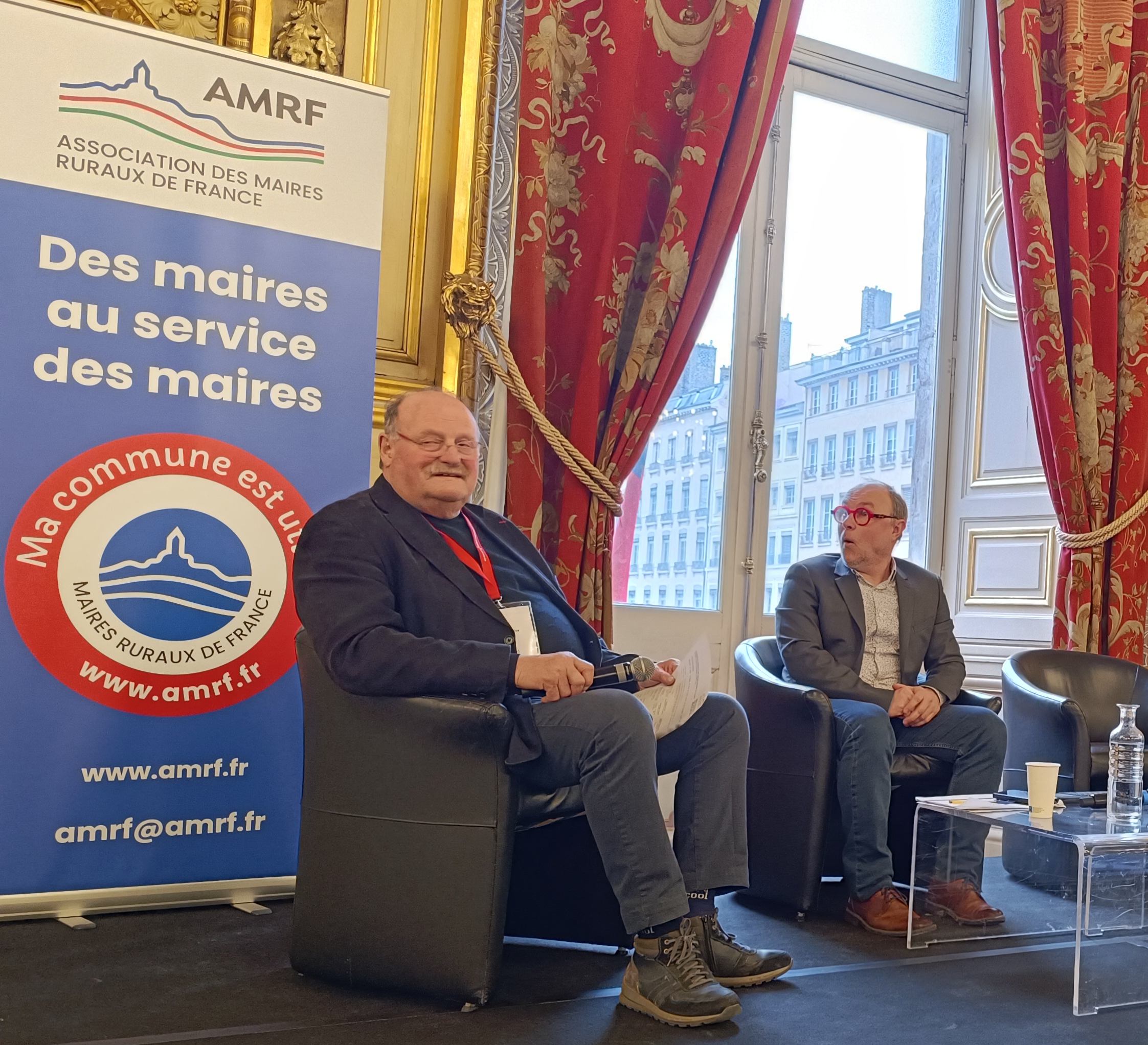Les pièges de l’appréciation du patrimoine rural : une lecture critique à partir des travaux d’Hervé Marchal
Lors d’une conférence organisée par l’Association des maires ruraux, le sociologue Hervé Marchal a identifié plusieurs biais dans la manière dont est perçu et valorisé le patrimoine rural. Ces biais, ou « pièges », structurent non seulement les discours sur le patrimoine mais aussi les politiques publiques qui lui sont consacrées. Ils contribuent, de manière plus ou moins insidieuse, à un déclassement du patrimoine rural et à une invisibilisation de certaines formes de transmission. À travers ces analyses, c’est une critique plus large des hiérarchies culturelles et territoriales qui se dessine.
1. Le piège de l’urbano-centrisme : la domination symbolique du patrimoine urbain
L’urbano-centrisme désigne cette tendance à évaluer le patrimoine rural à l’aune des catégories de pensée et des critères de légitimité propres aux espaces urbains. Comme le montre Hervé Marchal, ce biais conduit à un déclassement symbolique du patrimoine rural, considéré comme moins prestigieux, moins élaboré, voire anecdotique. Cette hiérarchisation repose sur un phénomène de violence symbolique (Bourdieu, 1979) : les ruraux eux-mêmes finissent par intérioriser cette dévalorisation, limitant ainsi leurs revendications patrimoniales.
2. Le piège de l’exceptionnalisme : une légitimité patrimoniale à géométrie variable
Le patrimoine légitime n’est pas une évidence en soi : il résulte d’un processus de sélection où certaines formes culturelles sont mises en avant au détriment d’autres. Ce que Marchal appelle le piège de l’exceptionnalisme fixe arbitrairement ce qui mérite d’être préservé. Cette logique exclut de nombreux éléments du patrimoine rural jugés trop modestes ou trop ordinaires. Pourtant, certains « presque rien » sont pour certains d’entre nous des « presque tout ». Ce qui fait patrimoine, c’est aussi l’attachement subjectif et les usages quotidiens qu’un groupe social entretient avec ses lieux et ses objets (Jeudy, 2001).
3. Le piège du matérialisme radical : l’oubli des patrimoines immatériels
Dans une perspective trop centrée sur le bâti et l’objet, les patrimoines immatériels sont souvent relégués au second plan. Pourtant, la mémoire des pratiques agricoles, les savoir-faire vernaculaires ou encore les récits locaux participent pleinement de l’identité d’un territoire. L’UNESCO a d’ailleurs reconnu depuis 2003 l’importance du patrimoine culturel immatériel, insistant sur son rôle fondamental dans la continuité des communautés. Dans les territoires ruraux, ce patrimoine est souvent porteur d’une transmission intergénérationnelle que les politiques publiques peinent à valoriser.
4. Le piège de l’auto-dévalorisation : la légitimité fragilisée des ruraux
L’un des effets les plus insidieux du déclassement symbolique du patrimoine rural est l’auto-dévalorisation des habitants eux-mêmes. Marchal souligne que les ruraux, convaincus de la moindre valeur de leur propre patrimoine, hésitent à le revendiquer et à investir dans sa préservation. Ce désengagement, souvent involontaire, résulte d’un long processus de minoration culturelle. Il en découle une forme de désengagement patrimonial, où l’absence de reconnaissance institutionnelle finit par décourager les initiatives locales.
5. Le piège du localisme : penser le patrimoine dans un système de relations
Contrairement à une vision essentialiste des territoires, la sociologie et l’anthropologie contemporaine rappellent que les espaces ruraux ne peuvent être pensés en vase clos. Certeau (1980) et Augé (1992) ont montré que les territoires existent d’abord par les relations qu’ils entretiennent avec d’autres lieux. Ainsi, penser le patrimoine rural comme une entité isolée de ses interactions avec l’urbain ou les territoires voisins, c’est en fausser la compréhension. Le patrimoine est un système en mouvement, traversé par des circulations, des influences et des réappropriations.
6. Le piège du monopole culturel : l’invisibilisation des cultures subalternes
Dans la hiérarchie des patrimoines, certaines cultures dominent et imposent leurs normes esthétiques et historiques. Ce « monopole culturel » tend à invisibiliser des formes de patrimoine jugées moins nobles ou moins conformes aux attentes institutionnelles. Les pratiques populaires rurales, les traditions orales ou les usages informels des paysages sont ainsi souvent négligés. Marchal invite à une déconstruction de ces monopoles, afin de redonner une place à des expressions culturelles marginalisées mais pourtant essentielles à la mémoire collective.
7. Le piège du passéisme radical : penser le patrimoine en mouvement
Enfin, l’un des biais majeurs de l’approche patrimoniale réside dans une vision figée du passé. Trop souvent, le patrimoine est pensé comme une relique, un vestige à préserver dans son état originel. Or, comme le rappelle Hervé Marchal, le patrimoine, ce n’est pas seulement le passé : c’est aussi le présent et les projections sur l’avenir. La patrimonialisation est un processus dynamique qui évolue avec les usages et les représentations collectives. Une approche trop passéiste risque d’empêcher l’émergence de nouvelles formes de patrimoine, adaptées aux enjeux contemporains des territoires ruraux.
En bref
L’analyse d’Hervé Marchal met en évidence les nombreux biais qui traversent l’appréciation du patrimoine rural. Derrière ces « pièges », c’est toute une structuration des hiérarchies culturelles qui se dessine, avec des effets très concrets sur la reconnaissance et la valorisation des territoires ruraux. En dépassant ces biais, il devient possible d’envisager le patrimoine autrement : non comme un objet figé, mais comme une ressource vivante, façonnée par les pratiques, les mémoires et les dynamiques contemporaines.