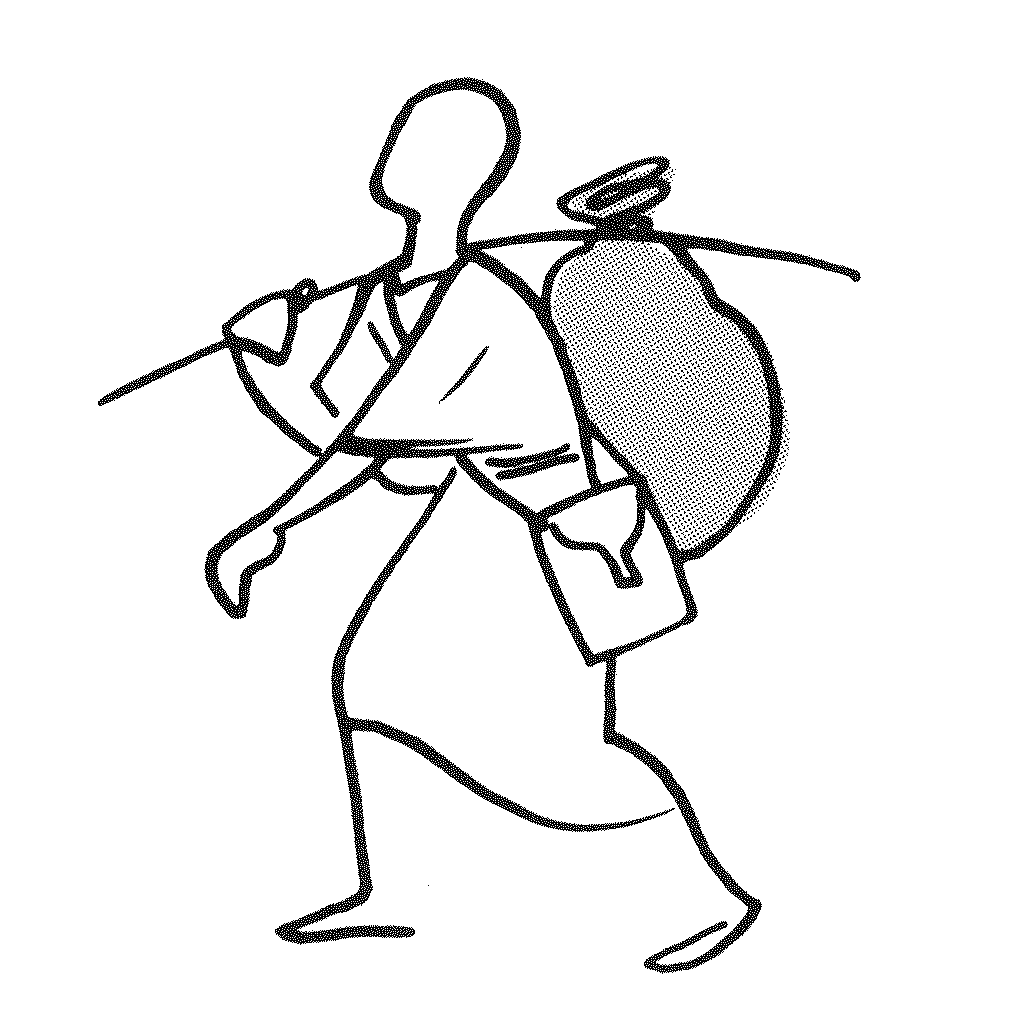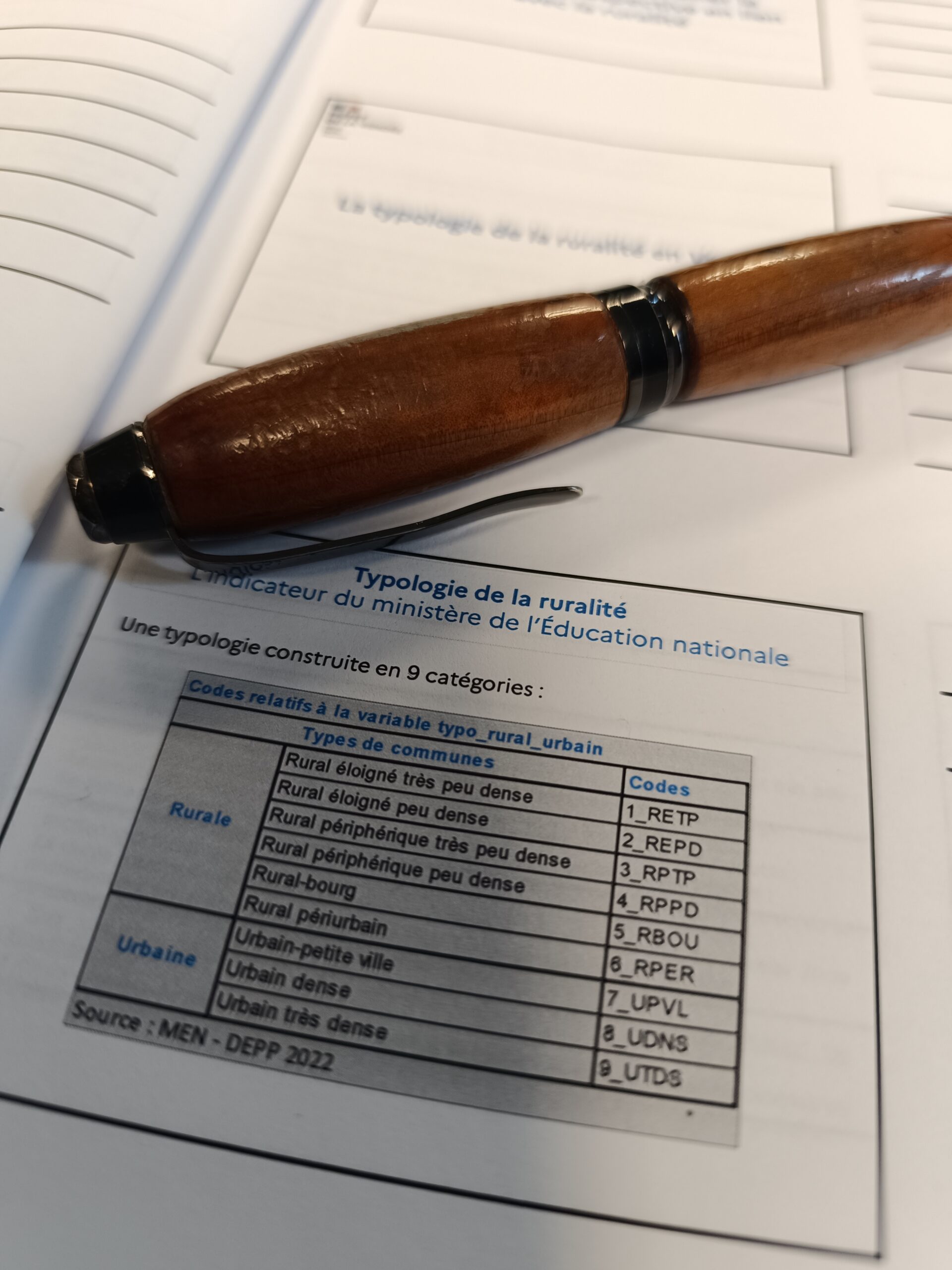Entre trajectoires imposées et dynamiques émergentes : les deux logiques cachées de l’action publique territoriale
La coexistence des paradigmes balistique et systémique dans la mise en œuvre des politiques publiques territoriales de l’État
La mise en œuvre territoriale des politiques publiques constitue un laboratoire permanent de l’action de l’État. Les dynamiques observables à ce niveau sont traversées par deux logiques souvent opposées : un paradigme balistique, issu d’une tradition centralisatrice et planificatrice, et un paradigme systémique, plus récursif, adaptatif et horizontal. Ces deux visions ne s’excluent pas, mais cohabitent dans les pratiques, les discours et les instruments de l’action publique contemporaine. Analyser leur articulation permet de mieux comprendre les tensions actuelles dans la conduite de l’action publique, ainsi que les malentendus qui surgissent parfois entre institutions et citoyens.