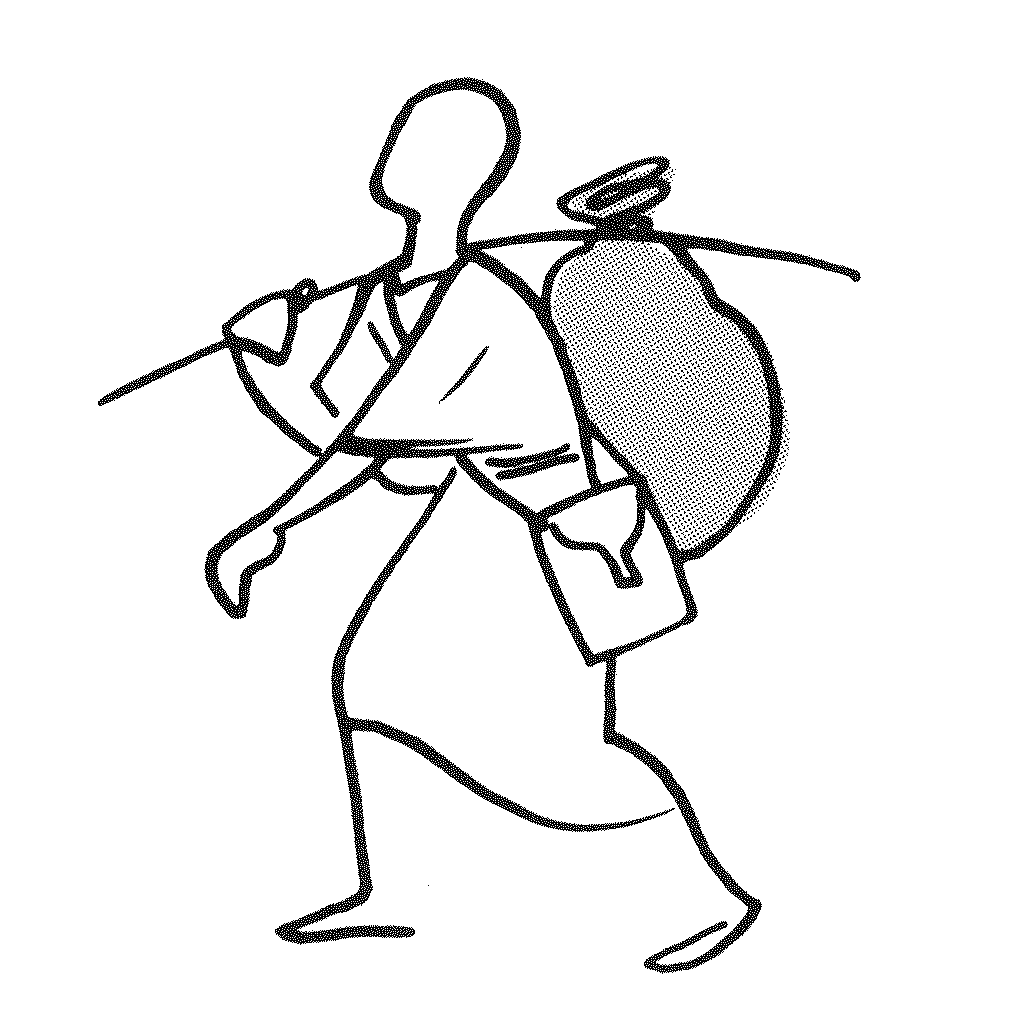Paul Ricœur et le fils prodigue
Il revient. Il ne sait pas ce qu’il attend. Au bout du chemin, un vieil homme le reconnaît. Il l’ embrasse. Il ordonne. Une tunique, un anneau, des sandales neuves. Et le veau gras. La fête.
Dans l’ombre, un autre homme s’indigne. Il n’a jamais fui lui. Jamais osé. Il est resté là, fidèle. Oublié.
On a tout dit sur la parabole du fils prodigue. Qu’elle parle de Dieu, du pardon, de la fraternité. Mais on dit rarement qu’elle parle de nous. De notre rapport au temps, au récit, à l’autre. De notre besoin de reconnaissance. De notre peur de perdre. Et surtout, de notre difficulté à pardonner.
Paul Ricœur nous invite à chercher dans cette célèbre parabole ce qui rend une vie intelligible. On peut alors trouver, dans ce récit biblique, une forme de réponse. Non pas une morale. Une structure narrative.
Car le fils prodigue, ce n’est pas un exemple. C’est une histoire. Une trajectoire. Un mouvement. Il quitte. Il chute. Il revient. Et ce retour, ce n’est pas un simple déplacement. C’est une refiguration de soi, pour reprendre les mots de Ricœur. Le moment où l’on recompose l’histoire à partir de la faille.
« Le pardon, écrit Ricœur, n’efface pas le passé. Il le transfigure. » Le père ne nie pas la faute. Il n’exige ni explication, ni remboursement. Il relance le récit. Il refuse que l’histoire se ferme sur la dette. Il ouvre un autre possible. Le fils revient, mais il ne revient pas au même endroit. Il revient comme un autre. L’histoire ne dit pas s’il est heureux. En tout cas, il est comme Ulysse.
Et l’aîné ? C’est lui, sans doute, le plus proche de nous. Celui qui ne comprend pas. Celui qui compte, qui compare, qui calcule. Celui qui vit dans le registre de la justice. Et qui ne supporte pas la logique du don. Il aurait voulu que le monde soit symétrique. Il découvre qu’il est asymétrique. Que l’amour du père n’est pas une balance, mais une promesse.
Ricœur, dans Parcours de la reconnaissance, parle de ce moment où l’on cesse de demander des comptes. Où l’on apprend à reconnaître l’autre comme un être faillible mais encore digne d’être aimé. Ce moment ne vient pas toujours. Il n’est pas garanti. Il est suspendu.
Le fils aîné, dans la parabole, reste dehors. La fête se déroule sans lui. Le texte ne dit pas s’il entre. Il nous laisse avec cette question. Sommes-nous prêts à réconcilier nos récits ? À accueillir l’autre non pas pour ce qu’il mérite, mais pour ce qu’il devient ?
C’est cela, peut-être, le cœur de la parabole : non pas le retour, mais la métamorphose du lien. Ce moment où l’histoire ne se résume plus à un tort et à une sanction, mais devient une narration.
Et si nous étions, tous, ce fils qui revient sans savoir s’il sera reçu ? Et ce frère, jaloux, blessé, qui attend qu’on reconnaisse sa fidélité ? Et ce père, vulnérable, qui pardonne avant même qu’on le lui demande ?
Alors la parabole devient une histoire pour apprendre à relancer les histoires. Même celles qu’on croyait terminées.